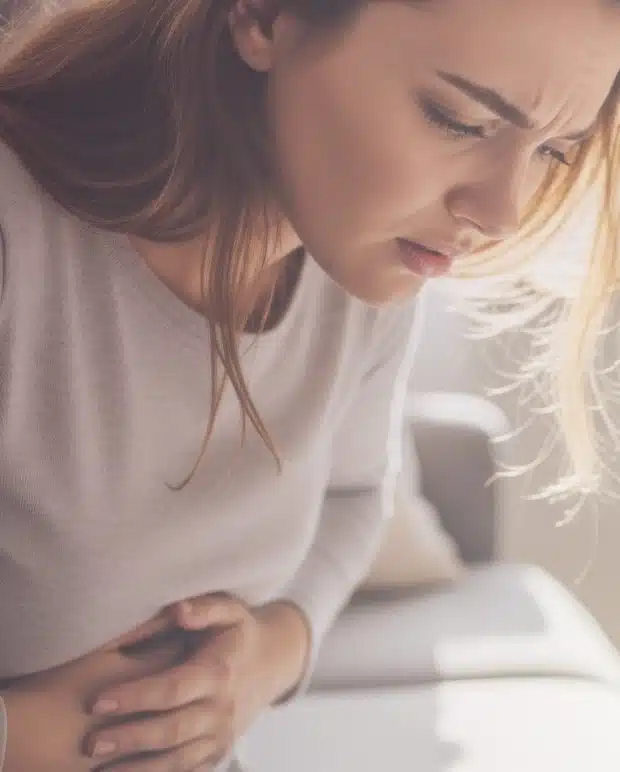Infertilité ou stérilité
Rencontrer des difficultés à concevoir concerne en France un couple sur huit. Parmi eux, pour 10 à 25% des couples, cette difficulté n’est attribuable à aucun défaut des deux partenaires. Une prise en charge médicale et une procréation médicalement assistée permettent de résoudre une grande majorité de difficultés à concevoir.

Exploration de l’infertilité
La Clinique de Fertilité traite diverses pathologies liées à l’infertilité. Nous offrons des bilans de fertilité approfondis pour les femmes et les hommes, et vous accompagnons à chaque étape de votre parcours vers la parentalité.
Qu’est-ce que l’infertilité ?
L’infertilité est définie comme la difficulté à concevoir un enfant. La probabilité de survenue d’une grossesse au cours d’un cycle menstruel, chez un couple n’utilisant pas de contraception, est de l’ordre de 20 à 25% par cycle. On parle d’infertilité en cas d’absence de grossesse malgré des rapports sexuels réguliers et non protégés pendant une période d’au moins 12 mois (définition de l’OMS).
Vécue comme très difficile voire déprimante par le couple, la situation d’infertilité peut avoir des origines multiples et parfois complexes.
Parfois, aucune cause n’est identifiée par les examens existants actuellement. Le rôle majeur du médecin de la reproduction est de diagnostiquer ces causes d’infertilité et de débuter les traitements adaptés, afin de permettre un début de grossesse.
Peut-on utiliser le mot “stérile” ?
Ce mot, portant une connotation biblique et mythologique, fait souvent peur, à travers la récurrente question des couples face à des difficultés de conception : « Suis-je stérile ? ».
Cependant le mot stérile revêt un caractère définitif et il est donc très rare d’avoir à l’utiliser. Un homme est stérile s’il ne fabrique pas, et ce, de façon définitive, de spermatozoïdes. Une femme peut être qualifiée de stérile si ses ovaires ont définitivement cessé de fonctionner ou s’il lui manque des organes majeurs de la reproduction tels que l’utérus ou les deux trompes. Le mot stérile n’est presque jamais utilisé en médecine de la reproduction.
Dans toutes les autres situations, qui sont bien plus fréquentes, on parle d’infertilité.
Touchant un couple sur six, l’infertilité correspond à l’incapacité de commencer une grossesse après un an de rapports sexuels non protégés.
Les problèmes d’infertilité touchent jusqu’à 15 % de la population en âge de procréer (un couple sur six). Au sein de cette population, 5% des couples obtiendront une grossesse spontanée au cours de l’année suivant le diagnostic posé.
Pour les couples infertiles, il existe bien souvent des solutions à proposer pour parvenir à la grossesse.
Quand consulter pour infertilité ?
Selon les recommandation du Collège National des Gynécologues et Obstétriciens Français, il est recommandé de consulter après un an d’essai infructueux si la femme est âgée de moins de 35 ans et après 6 mois d’essai à partir de 35 ans.
Par ailleurs, il faut consulter dès le désir d’enfant, sans attendre, dans les cas suivants :
- Antécédent chez un des deux membres du couple de traitements forts avec effet délétère sur la reproduction (chimiothérapie, traitement immunomodulateur, radiations)
- Antécédent chez la femme de chirurgie pelvienne (utérus, trompes ou ovaires)
- Troubles du cycles chez la femme : cycles irréguliers (trop courts, moins de 27 jours, ou trop longs, plus de 35 jours)
- Saignements en cours de cycle
- Antécédent d’infection génitale haute (salpingite, endométrite)
- Endométriose connue
- Suspicion d’endométriose (douleurs pelviennes chroniques, règles très douloureuses, douleurs pendant les rapports sexuels, troubles digestifs ou urinaires pendant les règles)
- Difficultés lors des rapports sexuels (absence de libido, douleurs vaginales, impossibilité à réaliser des rapports sexuels avec pénétration)
- Chez l’homme, antécédent de chirurgie urologique, de cryptorchidie (testicule haut situé dans le ventre, non descendu dans les bourses et opéré ou non dans l’enfance), de sondage vésical, d’infection urinaire
- Chez l’homme, prise de traitements destinés à augmenter la musculature et les performances sportives
- Difficultés sexuelles chez l’homme (trouble de l’érection ou de l’éjaculation)
Si aucune de ces situations ne vous correspond, si vous êtes en bonne santé et sans aucun antécédents sus-décrits alors laissez vous entre 6 mois et un an en fonction de votre âge avant de consulter pour laisser les chances à la grossesse de venir spontanément.
Tout savoir sur l’infertilité chez la femme
Quelles sont les causes de l’infertilité ? On trouve ici plusieurs pathologies et syndromes à l’origine des difficultés à concevoir.
L’endométriose
L’endométriose est une pathologie fréquente et mal diagnostiquée qui pourrait toucher jusqu’à 1 femme sur 10. L’endométriose se définit par la présence d’endomètre en dehors de la cavité utérine. L’endomètre est la muqueuse qui tapisse l’intérieur de la cavité utérine. Il grossit en première partie de cycle puis se charge en réserves énergétiques et se dote d’une vascularisation importante en deuxième partie de cycle. L’objectif de ces modifications est de préparer la nidation de l’embryon. En l’absence de grossesse, il n’y a pas d’HCG sécrétée pour stimuler les cellules du corps jaune (devenir du follicule après l’ovulation) et empêcher la survenue des règles. L’endomètre se détruit alors et se met à saigner. Dans l’endométriose, l’endomètre implanté en dehors de l’utérus (péritoine, ovaires…) subit les mêmes transformations que l’endomètre bien situé. Il en résulte des épisodes de saignement dans les zones qui ne sont pas prévues pour ça. Ces saignements seront responsables de douleur, d’inflammation, de kystes ovariens, d’adhérences entre les tissus et par conséquent, d’une diminution des chances de grossesse spontanée.
Le syndrome des ovaires polykystiques
Le syndrome des ovaires polykystique est une entité qui regroupe plusieurs signes associés : des cycles irréguliers, des signes d’hyperandrogénie (hirsutisme, acné, alopécie…) et des ovaires “riches” en échographie avec plus d’une quinzaine de petits follicules par ovaire. Le mot “polykystiques” portent à confusion car il laisserait sous-entendre la présence de kystes ovariens alors qu’ils s’agit d’ovaires qui sont riches en petits follicules et qui ne présentent aucun kyste.
L’insuffisance ovarienne
L’insuffisance ovarienne se définit grossièrement par une diminution de la “réserve ovarienne” c’est- à dire du nombre de petits follicules ovariens visibles à l’échographie qui sont disponibles pour la croissance folliculaire menant à l’ovulation. La réserve ovarienne se quantifie par l’échographie (compte des follicules antraux, c’est-à-dire des petits follicules visibles à l’échographie) et les dosages hormonaux (AMH et le couple FSH-Estradiol). Dans le cas extrême, il n’y a plus de réserve ovarienne et il est impossible de stimuler les ovaires. On parle dans ce cas d’insuffisance ovarienne prématurée ou de ménopause précoce.
Les fibromes utérins
Les fibromes, autrement appelés myomes, sont des petites boules de muscle qui peuvent avoir un impact plus ou moins marqué sur la fertilité. Les fibromes intra-cavitaires gênent la nidation et doivent être opérés. Pour les autres localisations de ces fibromes, le dossier doit-être discuté en fonction du profil de la patiente.
Les trompes bouchées ou infertilité tubaire
Les trompes permettent le passage des spermatozoïdes depuis l’utérus jusqu’à la portion la plus distale de la trompe où ils rencontrent l’ovocyte pour la fécondation. C’est aussi dans la trompe que l’embryon commence ses divisions cellulaire et est transporté jusqu’à la cavité utérine. Une infection des trompes (salpingite) peut avoir des séquelles et rendre une ou deux trompes incapables d’assurer leurs fonctions. Si la muqueuse est abîmée, les spermatozoïdes peuvent être gênés dans leur passage et l’embryon peut être bloqué dans la trompe au cours de son trajet vers l’utérus. On parle dans ce cas d’infertilité tubaire. La Fécondation In Vitro est une option obligatoire dans ce cas.
Isthmocèle
L’isthmocèle est une faiblesse de l’ancienne cicatrice de césarienne au niveau de l’utérus. L’isthmocèle peut être responsable de saignement de milieu de cycle et/ou d’infertilité “secondaire”, c’est-à-dire survenant après la naissance d’un ou plusieurs enfants, dont un par césarienne.
La thyroïde et infertilité
Le bon équilibre du fonctionnement de la thyroïde est nécessaire au bon déroulement de la grossesse. Les troubles de la thyroïde peuvent être associés à des fausses couches, à des pathologies obstétricales et des anomalies chez le fœtus.
Tout savoir sur l’infertilité chez l’homme
Côté hommes, les difficultés à concevoir peuvent être à l’origine de deux principales causes : les anomalies liées aux caractéristiques des spermatozoïdes, et les troubles sexuels.
Les anomalies du sperme qui sont diagnostiquées sont :
- la diminution de la concentration des spermatozoïdes (oligospermie)
- la diminution de leur mobilité (asthénospermie)
- la proportion de formes typiques (tératospermie)
Dans un cas extrême, il n’y a pas de spermatozoïdes dans l’éjaculat, c’est l’azoospermie.
La consultation pour infertilité est souvent l’occasion d’aborder le sujet tabou des troubles sexuels qui sont très fréquents chez l’homme. Certains hommes rencontrent une baisse du désir sexuel, des difficultés à l’érection ou des troubles de l’éjaculation. Ces difficultés sont bien connues de nos collègues urologues qui ont de multiples solutions pour les traiter.
Vous avez des questions ?
N’hésitez pas à nous contacter
LUN – SAM 9h à 18h
Bilan infertilité : quels examens ?
Le bilan d’infertilité recherche la cause de l’infertilité chez la femme et chez l’homme. On réalise d’abord un bilan de base puis on le complète si besoin avec des examens supplémentaires.
Chez la femme
On réalise un bilan hormonal en début de cycle (pendant les règles entre le deuxième et le quatrième jour). Il est très important de respecter le timing car le bilan serait ininterprétable si vous le réalisez à n’importe quel moment. Le but de ce bilan est d’évaluer la réserve ovarienne pour avoir une idée du fonctionnement des ovaires. Le couple FSH/ Estradiol ainsi que le dosage de l’AMH sont des bons reflets de la quantité de follicules prêts à démarrer leur croissance en début de cycle. Une FSH élevée est le reflet d’une insuffisance ovarienne. Devant la faible synthèse d’oestradiol par les ovaires, l’hypophyse (dans le cerveau) comprend le signal et augmente la sécrétion de FSH dans le but de recruter le plus de follicules possible. Une AMH basse est le reflet d’une faible réserve en follicules.
On réalise un bilan des trompes afin de savoir si elles sont perméables et si elles permettent la rencontre des gamètes. L’examen habituellement réalisé est l’hysterosalpingographie (hystéro = utérus ; salpingo = trompes et graphie = dessin). Cet examen doit être réalisé après les règles mais avant l’ovulation. Il consiste à faire des clichés de radiologie en même temps que l’on injecte un produit radio-opaque (visible à la radio). Il existe aujourd’hui un nouveau type d’examen pour explorer la perméabilité des trompes : l’HyFoSy ou HyCoSy qui consiste à injecter dans l’utérus une substance visible à l’échographie afin de vérifier le passage dans les trompes, sous contrôle échographique.
On réalise une échographie pelvienne en début de cycle ayant pour but d’étudier la morphologie de l’utérus et la réserve folliculaire dans les ovaires. Dans l’utérus, on recherche des éléments qui pourraient gêner la fertilité : une malformation utérine, un polype ou un fibrome qui impacterait la cavité utérine. La réserve ovarienne s’étudie en comptant les petits follicules que l’on identifie dans les ovaires.
On réalise parfois une hystéroscopie diagnostique lorsque nous suspectons un élément anormal dans la cavité utérine qu’il convient d’étudier au mieux. L’hystéroscopie se réalise habituellement en début de cycle et sans anesthésie. Le geste est simple et rapide. Il consiste à introduire un petit tube de 2 mm de diamètre dans l’utérus en passant par le col de l’utérus, tout en distendant la cavité utérine avec du sérum physiologique dans le but d’écarter les parois de l’utérus pour mieux les étudier.
Chez l’homme
Le spermogramme est l’examen de référence pour connaître les caractéristiques des spermatozoïdes. Le sperme est obtenu par masturbation au laboratoire puis étudié au microscope. Les paramètres étudiés sur le spermogramme sont la concentration des spermatozoïdes, le pourcentage de spermatozoïdes mobiles et le pourcentage de spermatozoïdes avec un “forme typique”.
Si les résultats sont anormaux, il faudra poursuivre les investigations avec la réalisation d’un bilan chromosomique (caryotype masculin), génétique (recherche de microdélétions du chromosome Y), morphologique (échographie des testicules et de la prostate), hormonal (pour évaluer l’origine centrale (cerveau) ou périphérique (testicules) d’une atteinte spermatique.